"On ne cesse de dépolitiser les émeutes»
Je vous livre ici un article intéressant sur un sujet qui l'est tout autant, pioché sur LIBERATION.fr... Michel KOKOREFF était présent au dernier débat du CCJ de Bondy en juin dernier, il était également présent à la dernière plateforme des droits de l'enfant et des jeunes du Conseil général de la Seine-Saint-Denis qui portait sur "la parole"... A BON ENTENDEUR, ECOUTONS !
A Bondy, nous allons créer de véritables espaces d'échanges et de dialogue avec les élus, les professionnels et les jeunes. D'ores et déjà, le Conseil Consultatif de la Jeunesse est en cours de redynamisation et les débats citoyens vont continuer sur des thématiques urbaines et sociétales au plus près des préoccupations des jeunes. Il reste que beaucoup d'élus sont prêts à recevoir qui le demandera, en direct... comme je vais le faire prochainement avec un groupe de jeunes de Delattre de Tassigny.
On ne cesse de
dépolitiser les émeutes»
-
Michel Kokoreff

Né en 1959, Michel Kokoreff est maître de conférences au département de sciences sociales de l'université Paris-V René Descartes et chercheur au Cesames (CNRS/Inserm). Il travaille depuis une quinzaine d'années sur les conduites et les représentations des jeunes de milieux populaires dans les quartiers pauvres. Il a publié les Mondes de la drogue (avec Dominique Duprez, Odile Jacob, 2000) ; la Force des quartiers. De la délinquance à l'engagement politique (Payot, 2003) ; la France en mutations. Quand l'incertitude fait société (avec Jacques Rodriguez, Payot, 2004). Il a récemment codirigé deux numéros de la revue Mouvements : «Les émeutes, et après ?» (n° 44, mars-avril 2006) et «La new droite. Une révolution néoconservatrice à la française ?» (n° 52, novembre- décembre 2007). Après avoir mené une enquête de terrain dans plusieurs communes de la Seine-Saint-Denis et un quartier populaire de Paris, il publie Sociologie des émeutes», (Payot, 2008), en librairie le 20 février.
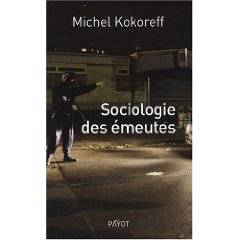
Pourquoi un nouveau livre sur les émeutes de 2005 ?
Je trouvais intéressant de mettre en perspective ces émeutes urbaines, d'une ampleur inédite, avec les manifestations anti-CPE qui les ont prolongées, et le regain de tensions qui a entouré le pseudo-premier anniversaire des émeutes avec la campagne présidentielle. Destiné à répondre aux problèmes des banlieues, le CPE a non seulement mis dans la rue une autre jeunesse que celle des cités, mais a été perçu comme une forme d'institutionnalisation de la précarité, il a rendu possible une unité inespérée entre étudiants, salariés et syndicats. Pourtant, la victoire de Sarkozy a constitué l'épilogue de cette séquence socialement et politiquement mouvementée.
Comment expliquez-vous cette séquence ?
Ces émeutes ont cristallisé et donné à voir des processus sociaux mettant en jeu l'ensemble de la société française. Je pense aux bouleversements structurels de la France urbaine, à la paupérisation d'une fraction des classes populaires et à l'ethnicisation des rapports sociaux.
Mais je pense aussi au rapport, pour le moins ambivalent, que nous entretenons avec les banlieues et les immigrés, entre rejet et compassion, comme avec les «forces vives» de ces quartiers dont on parle, assignées à résidence symbolique à travers les figures de «l'islamisme» et du «communautarisme», tout en étant valorisées à travers celles de la «diversité». Il fallait donc aller y voir de plus près. C'est aussi le métier de sociologue. Ne serait-ce que parce qu'il ne s'est pas passé partout la même chose durant ces trois semaines.
On s'est beaucoup intéressé à leurs causes. On s'est, par contre, peu préoccupé, à quelques exceptions près, de la géographie des périls. Le conflit entre jeunes et policiers est au coeur de l'émeute. S'il a beaucoup été question des conditions de vie des premiers, on a peu étudié les conditions de travail des seconds. Le rôle des acteurs intermédiaires (médiateurs improvisés ou pas, travailleurs sociaux, militants associatifs et politiques, élus locaux.) a également été peu traité. Or leur engagement permet d'expliquer les mécanismes de diffusion différentielle des violences. D'où l'enquête de terrain conduite dans plusieurs communes de la Seine-Saint-Denis (Saint-Denis, Clichy-sous-Bois, Montfermeil) et sur ce que j'appelle une «cité de banlieue à Paris». Lorsqu'on croise le regard des acteurs en jeu, on voit à l'oeuvre la violence des rapports sociaux. Au fond, l'émeute ne doit pas nous dissimuler cette violence sociale ordinaire qui se propage sans faire de bruit.

Quel bilan peut-on en tirer ?
Malgré ces actions collectives de grande ampleur, inédite dans d'autres pays européens, il semble que la société française dans son ensemble et la classe politique en particulier sont loin d'en avoir tiré toutes les leçons. Rien n'a changé plus de deux ans après dans les «quartiers». On l'a vu tout au long de 2006, puis lors des incidents graves de Villiers-le-Bel l'an dernier. L'élection de Nicolas Sarkozy marque la victoire d'une stratégie d'instrumentalisation politique des émeutes.
Les hommes politiques ont peu de stratégie payante, la sécurité en est une. Chirac en a fait l'expérience en 2002. Sarkozy, d'une certaine manière, a rejoué ce jeu en pariant sur les provocations verbales et l'indignation collective suscitées par les violences, pour mieux légitimer son discours d'ordre et passer à autre chose sans se cantonner au rôle de «premier flic de France». Cette stratégie, bien que cynique, a été gagnante. A la moindre occasion, on la verra réapparaître.

Les événements de 2005 ont-ils marqué une entrée en politique pour les jeunes émeutiers ?
On ne cesse de dépolitiser les émeutes. D'une double manière. D'un côté, en réduisant les émeutiers à des délinquants, pour faire des violences urbaines un phénomène essentiellement délictuel. D'un autre côté, en faisant de ces émeutiers des victimes d'une crise sociale, économique et urbaine, avec une vision teintée de misérabilisme des quartiers. Dans les deux cas, on passe à côté des dimensions politiques en jeu.
Comment les qualifier ?
C'est toute la difficulté. Il s'agit de considérer que l'on a affaire à des formes d'action politique non conventionnelles. Evidemment, brûler des voitures n'est pas un acte politique en soi mais il dit quelque chose. L'émotion collective, la colère, la rage, traduisent à la fois un désir de confrontation («Sarko démission») et une capacité d'interpeller l'Etat («Police partout, justice nulle part»). Il y a bien d'autres manières de le dire que la violence : par le rap, à travers le travail des militants de cité, les réseaux politisés mais non encartés, mais cela reste inaudible.
On a beaucoup dit et répété que les émeutiers n'avaient pas de revendications. Certes. Pourtant on sait ce que vit une partie non négligeable des jeunes qui habitent ces cités dégradées : le déni de citoyenneté, des humiliations ordinaires qui vont du délit de faciès au délit d'adresse. Bref, c'est un profond sentiment d'injustice et de mépris. D'où une demande d'égalité des droits, de reconnaissance, de respect.
Ces émeutes ont été un formidable court-circuit de toutes les médiations politiques, au sens conventionnel du terme. Les émeutiers et leurs relais sont arrivés à s'imposer comme acteurs, à imposer leur calendrier et à interpeller l'Etat au plus haut niveau. Dans ce sens-là, c'est une forme d'entrée en politique, un événement fondateur qui marquera toute une génération. Nul romantisme là-dedans. Car, pour autant, ces émeutes n'ont eu aucun débouché réellement politique. Ni les partis de gauche, ni les partis d'extrême gauche, ne se sont saisi de la question des quartiers populaires «immigrés». Quant à la droite, elle a, depuis longtemps, multiplié les signes d'ouverture, sans être beaucoup plus crédible sur le fond.

Quelle est l'articulation entre les émeutes de 2005 et les manifestations anti-CPE de début 2006 ?
On a beaucoup discuté des points communs et des différences entre ces deux actions collectives, y compris lorsque la violence des «casseurs» a occupé le devant de la scène. La continuité chronologique et politique déjà évoquée ne doit pas masquer la divergence du statut des participants aux émeutes et aux manifestations. En effet, les émeutes ont mis en scène des jeunes garçons issus des classes populaires, assimilés à l'immigration, peu politisés et encore moins syndiqués, en proie à l'exclusion sociale. Les manifestations anti-CPE firent apparaître les différentes figures d'une jeunesse lycéenne et étudiante, composée de filles et de garçons issus en majorité des classes moyennes, ayant en commun de miser son avenir sur la réussite scolaire pour échapper à la précarité incarnée par le CPE. Et encore cette vision est-elle trop simple. Ainsi, on aurait tort d'unifier la situation sociale des quartiers populaires et les caractéristiques des populations qui y vivent.
De même, les protestations collectives - ayant mobilisé les lycéens, les étudiants et les salariés contre le CPE - traduisent l'hétérogénéité des positions face aux ressources scolaires et des conditions de vie. Il reste que, malgré leur différence intrinsèque, ces deux formes de protestation collective sont peu concevables dans des sociétés occidentales où individualisation et dépolitisation sont allées de pair.

Vous dites que «la haine du flic a remplacé la haine de classe».
On vivait auparavant dans une société fortement structurée par des clivages de classe et évidemment dans les milieux populaires : l'ennemi de classe était lié au monde du travail dont la traduction politique était claire. On vit désormais dans une société où les clivages de classe se sont fortement effacés sans avoir pour autant disparu, où dans les «quartiers», les jeunes générations ont des performances scolaires en hausse mais sont handicapées par les discriminations à l'embauche. Pour les plus exclus, les jeunes du ghetto profond, comme le disent certains, le travail est un monde abstrait, hors de portée. Dans ce contexte-là, la police joue un rôle capital.
D'un côté, c'est l'ennemi principal, jeunes et moins jeunes y sont confrontés au quotidien avec tout ce que l'on connaît sur les contrôles d'identité multiples, les provocations verbales, les coups de pression ! D'un autre côté, quand on parle avec des jeunes de ces cités, notamment les «petits», chacun évoque des situations traumatisantes. Il y a un contentieux très fort, d'ailleurs inimaginable quand on vit hors de ces quartiers. Mais, par ailleurs, se cristallise sur la figure du policier, une somme de sentiments, d'expériences, d'injustices, de formes de domination qui n'arrivent pas à se dire dans le langage des classes, la grammaire du monde du travail, dans les conflits de l'entreprise. Donc, la haine du flic correspond à une expérience directe, mais en même temps, elle offre un langage pour évoquer malaises et frustrations.
Vous pensez que les rapports jeunes-police se sont encore dégradés.
Le contentieux entre les jeunes et la police date du début des années 70 avec les premières émeutes de la banlieue lyonnaise. C'est une question centrale qui est mise sur le devant de la scène par un certain nombre d'acteurs mais qui, en même temps, ne cesse d'être refoulée, oubliée. Après l'épisode de SOS Racisme, dans les années 80, qui traduit l'évacuation des problèmes d'ordre public au profit des problèmes de l'école et de l'insertion professionnelle, on assiste à un retour du refoulé : ce sont les émeutes de Vaulx-en-Velin.
Depuis, la dégradation des rapports jeunes-police est illustrée par les outrages qui explosent à partir du milieu des années 90. Ce sont les premiers signes d'une politique plus sécuritaire qui vise à renforcer les interpellations. Mais ce sont aussi les comportements qui changent dans un contexte social plus dur et une plus grande concurrence dans l'accès aux ressources (argent facile, trafics illicites). Comme le rappelait Dominique Monjardet [sociologue, grand spécialiste des questions de sécurité et de délinquance, disparu en 2006, ndlr], l'outrage est un aveu d'incompétence. C'est une relation qui est mal maîtrisée par le fonctionnaire de police. Un indice plus qualitatif de cette dégradation, c'est l'ambiance des quartiers. Celle-ci est marquée par les tensions et les embrouilles, la méfiance et la violence gratuite, entre les habitants eux-mêmes.

Villiers-le-Bel a-t-il marqué une gradation supplémentaire dans les violences ?
C'est à la fois la même histoire et une histoire différente. La même histoire car l'élément déclencheur, c'est un accident de la route, la police est d'emblée mise hors de cause, ce qui attise colère et dégradations. Mais aussi différente, dans le sens où la situation a été tout de suite extrêmement violente avec les tirs de grenaille sur les CRS. Cela a duré deux jours. Toutefois, je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un tournant. On sait qu'il y a des armes dans les quartiers. Ceux qui détiennent des armes, sont des équipes qui s'en servent pour leur business. Ce n'est pas pour brûler des voitures. Ce qui est à craindre, c'est que faute de prendre le mal à la racine, on ait une sorte de surenchère qui conduise à l'emploi d'armes de poing à balles, et non plus de grenaille.
Selon vous, c'est moins la pauvreté que les écarts sociaux qui provoquent les émeutes ?
Les problèmes jeunes-police comme la délinquance ne doivent pas masquer les facteurs structurels. Si on prend la région parisienne, les contrastes entre des zones riches et des zones pauvres sont générateurs de frustrations et de ressentiments. Quelques chiffres en donnent un aperçu : au 31 décembre 2006, 25 % de la population de Seine-Saint-Denis de moins de 65 ans vivaient sous le seuil des bas revenus (845 euros par mois), soit trois fois plus que dans les Yvelines (8,5 %) et près de deux fois plus en moyenne qu'en Ile-de-France (13,9 %). Les inégalités territoriales en matière d'accès à l'emploi et de chômage sont extrêmement fortes, en particulier à l'échelle infracommunale, avec un écart qui peut aller d'un à quatre. L'accessibilité urbaine de certaines communes ou cités est une catastrophe. Ce n'est pas une pauvreté absolue, comme celle que l'on constate dans certaines zones urbaines d'Argentine ou du Brésil, c'est une question de contrastes.
Vous écrivez que les quartiers populaires sont devenus des ghettos.
C'est un grand débat. On peut penser qu'il y a deux hypothèses possibles. L'une consiste à prendre acte des formes de marginalisation urbaine qui fabriquent les espaces de relégation dont certaines cités et grands ensembles sont le symbole, sans aller jusqu'à considérer que la radicalisation de cette situation sociale conduit au ghetto.
L'autre hypothèse admet que la pauvreté urbaine, la ségrégation, le racisme contribuent à former un ghetto, ce qui renvoie à la logique coloniale. De ce point de vue, la racialisation et l'ethnicisation des rapports sociaux sont des processus au coeur de la culture française, ils constituent un puissant déterminant de la vie sociale et urbaine. Autrement dit, on voit se superposer des formes urbaines d'inégalités et de discriminations, qui ne participent pas d'un système général mais qui ont chacune leur logique propre. En clair, cette question est extrêmement complexe : nous sommes confrontés en permanence à une hétérogénéité des logiques ou des scènes. C'est toute la difficulté de notre travail de sociologues, penser toujours en terme de reliaison.
